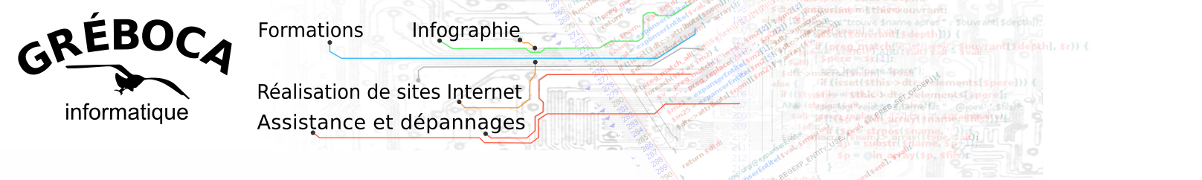- Novembre 2020 -
Sommaire
Michel Pigenet est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est spécialisé dans le monde du travail au XIXᵉ et XXᵉ siècle, notamment à travers l’histoire du syndicalisme et des mouvements sociaux en général. Pour LinuxFR.org il nous fait l’amabilité de revenir sur la fameuse loi des associations 1901, qui même si techniquement a été votée au XXᵉ siècle, est bien le fruit d’une évolution des droits des citoyens qui a eu lieu au XIXᵉ siècle. Il a bien voulu répondre à nos questions, en nous rédigeant un texte qui se lit comme un livre d'histoire.
En sa compagnie nous allons traverser tout le XIXᵉ siècle pour tenter de comprendre les circonstances de la création de cette loi. Nous ouvrirons également sur l'évolution et le rôle des associations au XXᵉ siècle, et enfin nous nous interrogerons sur le futur de ce statut.
Le texte est sous licence non libre CC-BY-ND, toutefois précisons que les ajouts d'hyper-liens sont du fait du rédacteur du journal et non de Michel Pigenet.
L’évolution des libertés au XIXᵉ siècle
Le XIXᵉ siècle a vu une succession de formes de gouvernements très différentes, alternant monarchies (Louis XVIII, Louis Philippe), empires (Napoléon, Napoléon III), et républiques (2ᵉ et 3ᵉ). Qu’en est-il des libertés fondamentales du peuple : assiste-t-on à une ouverture progressive ou y a-t-il eu des "sursauts" (voire des retours en arrière) ?
Si l’aspiration à la liberté est aussi ancienne qu’ont été variés les contenus et contours qu’elle recouvrait, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 énumère, dès les premiers temps de la Révolution, les libertés associées à la reconnaissance de droits naturels, « inaliénables et sacrés », et base juridique de la société qui émerge. Les articles 10 et 11 mentionnent celles d’opinion, « même religieuse », de « libre communication des pensées et des opinions » par la parole, l’écrit et l’impression. Aucun des régimes qui se succèdent au XIXᵉ siècle n’osera remettre en cause ce socle fondamental. En principe, du moins, car, tandis que d’autres libertés sont revendiquées et spécifiées, à l’exemple de la liberté de circulation, de réunion, de manifestation et, donc, d’association, les débats font rage autour de leurs conditions d’exercice. Fermés à l’acceptation de nouveaux droits, monarchies censitaires et régimes impériaux restreignent la jouissance de libertés soumise au bon vouloir de l’administration. Si les républicains ne sont les seuls à réclamer l’extension des libertés individuelles et collectives, ils apparaissent comme les plus résolus dans ce combat. Les premiers mois et la Constitution de la Seconde République le confirment en 1848, avant que le parti de l’Ordre amende les avancées réalisées qu’anéantit le coup d’État de décembre 1851, puis l’instauration du Second Empire. Les ultimes concessions qui précèdent sa chute en 1870 ne satisfont pas les républicains, qui mettront toutefois près d’une décennie pour conquérir toutes les institutions d’une Troisième République incertaine. C’est chose faite en 1879. Deux ans plus tard, deux lois élargissent les libertés de presse et de réunion. En 1884, une autre établit la liberté de s’organiser en syndicat, première étape, dont sont exclus les fonctionnaires, vers une liberté d’association étendue en 1898 aux mutuelles, mais que beaucoup de républicains hésitent toujours à généraliser avant 1901.
Le vote
Le vote lui-même a-t-il été le fruit d’un combat (au sein de l’assemblée et dans l’opinion publique) ou est-ce qu’un consensus a rapidement été trouvé entre les différents camps ? Est-ce qu'à l’époque ce fut médiatisé et accueilli par le peuple comme une victoire, ou est-ce que c’est passé finalement relativement inaperçu ?
Le « moment 1901 » procède d’une réalité antérieure : depuis des années, le nombre des associations n’a cessé de croître. En 1900, l’Office du travail en recense plus de 45 000, dont un quart de sociétés de secours mutuel, en tête devant les syndicats et les organisations sportives ou de jeux – 16 % chacun -, les associations musicales – 14 % -, les cercles – 8 % -, les sociétés scolaires – 5 % - et les coopératives – 4 %. À la même date, l’économiste et coopérateur Charles Gide double ce total et recense 90 000 associations autorisées. Déjà, plusieurs ligues préfigurent les mouvements de masse à venir. À droite, la Ligue de la patrie française annonçait près de 500 000 membres en 1898, soit 20 fois plus que la Ligue des droits de l’Homme, à gauche, cependant que la Ligue de l’Enseignement fédère un réseau serré de 2 600 associations locales. Face à cette poussée intervenue sans entraîner de troubles à l’ordre public, l’ancienne législation restrictive n’est plus adaptée aux réalités de l’époque. En pratique, les citoyens désavouent l’héritage anti-individualiste républicain remis en question par des intellectuels attachés au régime, mais qu’inquiète l’atomisation des individus dans une société moderne menacée d’anomie. Non sans emprunt au corporatisme d’antan, des juristes et des sociologues prônent « l’organisation de la démocratie », la représentation des intérêts au sein de l’État et au moyen des associations, voire envisagent la « syndicalisation générale de la société ».
Cet arrière-plan socio-idéologique posé, le vote de la loi de 1901 n’est pas étranger à une conjoncture politique marquée par l’Affaire Dreyfus et ses suites. La République, désormais bien enracinée dans le pays, a surmonté une crise surgie du cœur de l’appareil d’État sans renier ses principes. Elle a entraîné une recomposition des forces politiques et rapproché les diverses composantes de la gauche, plus que jamais hostile aux congrégations catholiques, notamment les Assomptionnistes et leur journal La Croix, en pointe dans le combat contre Dreyfus. Là réside, d’ailleurs, l’une des principales réticences envers la reconnaissance de la liberté d’association. Il n’empêche, l’initiative d’un projet de loi en ce sens vient, le 14 novembre 1899, de Pierre Waldeck-Rousseau, chef d’un gouvernement de « défense républicaine » et ministre de l’Intérieur et des Cultes.
À cette date, les clivages nés de l’Affaire n’ont rien perdu de leur acuité. Sans provoquer d’affrontements de rue, le débat est houleux par presse interposée comme au Parlement, où il commence le 15 février 1901. Si l’on discute du statut des associations étrangères, le sort réservé aux congrégations suscite les plus vives controverses. Lors des ultimes séances des 22 et 28 juin au Sénat et à la Chambre des députés, le vote est accueilli aux cris de « Vive la République ! ». « Vive la liberté ! » répondent des élus de droite opposés au régime d’autorisation préalable maintenu pour les congrégations.
Pour toutes les autres associations sans but lucratif, respectueuses de la « forme républicaine de gouvernement », des « bonnes mœurs » et de l’intégrité du territoire, la loi promulguée le 1ᵉʳ juillet 1901 met fin, en effet, à cette obligation. Facultative, la déclaration auprès de l’administration, réduite au dépôt de son titre et à la communication de son objet, de son siège, de l’identité de ses administrateurs et de ses statuts, permet d’ester en justice et de disposer de biens propres nécessaires à ses activités. La loi, qui ne s’applique qu’à l’intérieur du territoire métropolitain, prévoit trois cas particuliers. Les associations étrangères entrent dans le cadre de la loi, mais peuvent être dissoutes par voie administrative. Les groupements reconnus « d’utilité publique » par décret du Conseil d’État au terme d’une longue procédure, jouissent par ailleurs du droit de recevoir des dons et des legs en vue d’accomplir une œuvre « d’intérêt général ». Enfin, le point le plus controversé concerne les congrégations, dont l’autorisation dépend d’un décret publié après avis du Conseil d’État et recensement des biens. Celles qui existaient avant 1901 ont trois mois pour régulariser leur situation. Retenons encore qu’en 1905, la loi de Séparation de l’Église et de l’État confie à des « associations cultuelles » le soin, exclusif de tout autre, de subvenir aux frais et à l’entretien des lieux de culte, notamment des églises qui, laissées à la disposition des fidèles, restent propriété des communes. Ces associations à but non lucratif relèvent de la loi de 1901, mais leurs statuts doivent être validés par l’administration. Pour mémoire, les catholiques refusèrent d’abord d’en créer, avant d’accepter, en 1924, le compromis d’associations diocésaines placées sous la responsabilité des évêques.
Et pourquoi pas plus tôt ?
Aujourd'hui nous trouvons normal de pouvoir s’associer librement sans déclaration préalable, mais ce n’était pas le cas avant 1901 (en 1810 Napoléon interdit tout regroupement de plus de 20 personnes, cette loi étant valide jusqu’en 1901). Que craignaient les gouvernements pour ne pas laisser les citoyens libres de s’associer ? La liberté de la presse a été proclamée quelque 20 ans plus tôt par exemple.
Cette issue était attendue. Pour la seule période allant de 1871 à 1899, pas moins de 33 projets et propositions de lois avaient été déposés. Si l’on remonte plus haut dans le temps, la Révolution française est impensable sans le foisonnement des « clubs » et des « sociétés » qui, à Paris comme dans les profondeurs du pays, participent à ses débats, reflètent ses tensions, voire précipitent ses événements. Le 14 novembre 1790, une loi en prend acte, permettant aux citoyens « de s’associer paisiblement et de former entre eux des sociétés libres », droit bientôt inscrit dans la constitution de septembre 1791, puis dans celle de 1793. Entre 100 000 et 200 000 citoyens sont membres, alors, des sociétés « populaires » ou « révolutionnaires » formées dans plus de 5 300 communes. Dès ce moment, pourtant, des critiques s’élèvent contre des associations, dont Sieyès craint qu’elles contrarient la liberté individuelle, à l’exemple des vœux exigés par… les congrégations. Nombre de révolutionnaires se méfient par ailleurs d’une possible résurgence des corps intermédiaires qu’ils viennent d’abolir. Beaucoup voient dans les associations le ferment de divisions qui fragiliserait l’unité de la nationale et le risque de contre-pouvoirs menaçant la légitimité des institutions, de l’État et des élus, seuls en mesure d’exprimer l’intérêt général envers et contre tous les intérêts particuliers. Après la suppression des corporations en mars 1791, la loi Le Chapelier invoque, en juin, le maintien de l’ordre public pour interdire les coalitions motivées par la défense de « prétendus intérêts communs ». Un mois plus tard, une autre loi restreint la liberté des sociétés et des clubs tenus de déclarer les lieux et dates de leurs réunions.
L’autoritarisme napoléonien va plus loin. S’il tolère la représentation des intérêts de la bourgeoisie au sein des chambres de commerce, des arts et manufactures et l’organisation de professions jugées politiquement stratégiques (bouchers, boulangers…), il se montre intransigeant à l’égard des associations ouvrières ou politiques. En 1810, les articles 291 à 294 du Code pénal instaurent le régime de l’autorisation préalable, « sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer », les associations de plus de 20 membres. Passer outre expose leurs responsables à des peines de 3 mois à 2 ans de prison et ceux qui les hébergeraient à de fortes amendes.
Si la Restauration maintient la législation en place, la nostalgie de l’Ancien Régime et de ses corps intermédiaires l’amène à se montrer moins rigoureuse vis-à-vis d’associations ouvrières de secours mutuels ou de bienfaisance dépourvues d’ambitions subversives. Après 1830, la Monarchie de Juillet, libérale en matière d’économie ne l’est guère sur le plan politique. Face aux progrès de la propagande républicaine, la bien nommée « loi d’inquiétude » du 10 avril 1834 durcit la législation antérieure. Ainsi l’autorisation préalable, dorénavant révocable à tout moment, est-elle étendue aux associations qui avaient cru y échapper par leur fractionnement en sections de moins de 20 membres. Les sanctions, jusque-là applicables aux seuls dirigeants, sont élargies à tous les adhérents et alourdies. Cette fermeté coexiste toutefois avec la bienveillance manifestée à l’égard des sociétés savantes, d’anciens élèves ou d’éducation populaire.
En avril 1848, le gouvernement provisoire proclame que « les clubs sont pour la République, un besoin, pour les citoyens, un droit ». La répression des journées de juin 1848 s’accompagne d’une mise en cause des sociétés politiques et ouvrières. En juillet, un décret réitère la liberté d’association. Une simple déclaration suffit, mais les organisations ont l’obligation de rendre publiques leurs séances, soumises à la surveillance des autorités, qui peuvent saisir la justice contre celles qui poursuivraient des objectifs subversifs. Si la Constitution de la Seconde République reconnaît « le droit de s’associer et de se rassembler paisiblement et sans armes », une série de lois frappent, dès l’année suivante, les clubs, les réunions estimées dangereuses pour la sécurité publique, tandis que les tribunaux dissolvent à tour de bras. La fenêtre ouverte en 1848 achève de se refermer au lendemain du coup d’État du Président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Le 25 mars 1852, un décret rétablit le régime de l’autorisation préalable sur fond de chasse aux opposants. La situation change, toutefois, dans les dernières années plus libérales du Second Empire. En 1868, le pouvoir concède le droit de réunion sous condition de déclaration préalable, tandis que des chambres syndicales et des sociétés ouvrières, défiant la loi, agissent au grand jour.
Deux ans plus tard, la chute de Napoléon III et le rétablissement de la République précipitent l’essor associatif. Le fait, toutefois, précède le droit, inchangé sur ce plan. Dans le sillage de la répression de la Commune, une loi prévoit des peines de 3 mois à deux ans de prison pour les membres d’« associations qui auraient pour but de provoquer à la suspension du travail, à l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion… » Léon Gambetta, adversaire de la majorité conservatrice issue des urnes et, jusque-là, partisan d’une liberté d’association « pleine et entière », nuance son engagement au moment où, en 1876, les républicains remportent les élections. « Pas tout de suite », tempère-t-il, pour donner la priorité aux libertés de presse et de réunion… À sa gauche, les radicaux et les socialistes n’admettent pas ce recul, justifié par hostilité envers les congrégations. À défaut, les républicains de gouvernement font une exception pour les syndicats, en 1884, puis, en 1898, pour les sociétés de secours mutuels, qu’une simple déclaration suffit à constituer. Pour le reste, la loi de 1834 demeure en vigueur. Des tribunaux le rappellent qui, l’année du centenaire de la Révolution, répriment la création sans autorisation d’associations de plus de 20 personnes. Ironie de l’histoire, les républicains paraissent sur la défensive face aux conservateurs, qui multiplient les propositions d’extension. Nul n’en doute, les congrégations sont l’enjeu de cette bataille à front renversé qui trouve la solution que l’on sait en 1901.
Évolution au XXᵉ siècle
Plus d’un siècle d’associations loi 1901 s’est écoulé. Le paysage des associations aujourd’hui doit être bien différent de celui originel. Pouvez-vous nous décrire cette évolution ?
Sans surprise, on constate des fluctuations, au gré des conjonctures politiques, dans l’interprétation de la loi. Ainsi la loi du 10 janvier 1936 permet-elle la dissolution des ligues paramilitaires d’extrême droite qui menacent la « forme républicaine de gouvernement », mais aussi des mouvements nationalistes ou régionalistes susceptibles de porter atteinte à l’intégrité nationale. En 1939, de nouvelles dissolutions frappent les organisations communistes, interdiction que le régime de Vichy élargit aux confédérations syndicales et à de nombreuses associations. En 1968, 1972 et 1986, des textes viseront tour à tour des groupes d’extrême gauche, la propagation du racisme ou l’apologie du terrorisme.
Dans l’ensemble, pourtant, l’évolution intervenue s’est opérée dans le sens d’une extension tant des droits que de la variété et des forces du fait associatif. D’abord proscrits, les syndicats de fonctionnaires sont tolérés en 1924, avant d’être officiellement reconnus en 1946. Les dernières restrictions appliquées aux organisations d’étrangers sont levées en 1981. Après une période de fermeté, les congrégations, elles-mêmes, bénéficient, union sacrée oblige, d’une indéniable bienveillance pendant la Première Guerre mondiale, qui se prolonge dans l’entre-deux-guerres et que l’État français confirme en modifiant la loi de 1901. La liberté d’association est enfin peu à peu appliquée dans les colonies, de l’Algérie en 1904 à l’AEF-AOF en 1946. En métropole même, l’Alsace-Moselle fait exception sur ce plan comme sur bien d’autres – régime des cultes, protection sociale, etc. Le retour de la province à la France après la Première Guerre mondiale n’entraîne pas, en effet, l’abolition de toutes les lois du Reich. Ainsi en va-t-il avec celle de 1908 sur les associations et ce qu’en disait le Code civil allemand, qui leur adjoint les sociétés. En conséquence, les associations d’Alsace-Moselle peuvent poursuivre des buts lucratifs. Le droit local distingue encore les groupements « inscrits » auprès de l’administration de ceux qui ne le sont pas. Dans le premier cas, la demande est soumise à un contrôle du tribunal judiciaire susceptible de déboucher sur un refus, par exemple si le nombre d’adhérents est inférieur à sept. Le même tribunal est autorisé à vérifier qu’ils ne sont pas tombés au-dessous de ce plancher. En contrepartie, elles disposent d’une capacité juridique supérieure à celles reconnues d’utilité publique sous le régime de la loi de 1901.
En 1950 et 1956, deux arrêts du Conseil d’État ont consolidé le caractère institutionnel de la liberté d’association rangée parmi « les principes fondamentaux de la République ». En juillet 1971, le Conseil constitutionnel confirmera, en juillet 1971, cette interprétation par la condamnation d’un refus administratif de délivrer le récépissé de déclaration d’une organisation au motif qu’on la suspectait de reconstituer un groupe d’extrême gauche récemment dissout. Sans écarter la possibilité de restrictions, le Conseil repoussait l’établissement d’une autorisation judiciaire comme préalable à la procédure de déclaration.
Le rôle économique des associations
À l’échelle nationale, les associations loi 1901 ce sont 1,2 million d’associations, 23 millions de membres (1 citoyen sur 3 !) mais aussi 1,5 million d’ETP. Le rôle social des associations est évident, mais qu’en est-il de son rôle économique ? Est-il reconnu à sa juste valeur ?
S’agissant du regard porté par la société, il est clairement favorable, si l’on en croit deux sondages datés de 2019. Dans l’un 89 % des personnes interrogées – 94 % des moins de 35 ans - déclarent avoir une « bonne opinion » des associations en général. Dans l’autre, plus spécialisé, le taux atteint 79 % pour les associations de quartier et 76 % pour celles engagées dans l’action humanitaire et caritative. Résultats à comparer avec ceux des syndicats (34 %) et des politiciens (20 %). 88 % des sondés estiment prioritaire une gestion sociale irréprochable, ce que ne garantit pas toujours l’hétérogénéité des statuts, voire la précarité, des salariés du monde associatif. Le rôle économique de ce dernier n’est envisagé qu’à travers la question de son financement. Sur ce point, 86 % jugent primordial l’équilibre budgétaire des associations humanitaires et caritatives ; 79 % les encouragent à être moins dépendantes des subventions publiques.
Ceci noté, par-delà la très large diversité associative, les adhérents privilégient les activités sportives – 41 % - et de loisirs – 20 % -, devant la culture – 17 % - et le caritatif – 13 %. Quant aux types d’engagements, le militantisme et le bénévolat composent toujours plus avec les attentes consuméristes des membres et la nécessité de recourir à des experts, évolution propice à la professionnalisation-salarisation d’une partie des cadres des plus grandes organisations, par ailleurs en compétition dans la collecte de fonds, notamment dans le secteur humanitaire.
Le budget total des associations s’élevait à 113,2 milliards € en 2017. La somme donne la mesure du poids économique du fait associatif, quand les dépenses de l’État se situaient, la même année, autour de 417 milliards €. La comparaison est d’autant moins dénuée d’intérêt que, sans même parler des « associations administratives » issues d’entreprises publiques ou à financement public majoritaire, les associations ont souvent pris le relais d’un État social pressé de se désengager ou de redéfinir les priorités de son intervention directe dans des domaines aussi variés que l’assistance, le troisième âge, la formation, les sports, les loisirs, etc. Modalité d’une vertueuse subsidiarité ou sous-traitance de l’impuissance publique ? Un peu des deux, probablement, mais l’évolution n’est pas allée sans rejaillir sur la nature, les responsabilités, le financement, le fonctionnement et l’indépendance du mouvement associatif.
Cela, jusqu’à ce que la pandémie de 2020, à l’origine de mesures inédites de confinement et de règles de distanciation sociale, entraîne de graves perturbations dans l’ordinaire de la vie associative. On songe ici aux sociétaires les plus exposés aux formes graves du covid-19, en premier lieu les personnes âgées, que l’on sait nombreuses parmi les bénévoles. Il est à craindre que la crise économique et sociale provoquée par le désordre sanitaire ne vienne aggraver ces difficultés, pour ne rien dire des rentrées de cotisations.
Et demain ?
Pensez-vous qu’on doive craindre pour ce statut si simple et si ouvert ? Voit-on des prémisses de remise en cause, tant par les gouvernants que par une sorte d’égoïsme ambiant ?
L’historien n’est jamais très à l’aise avec une question qui sollicite d’incertains dons divinatoires… On l’a vu, le mouvement associatif, dans son extrême diversité, a fait la preuve de son utilité sociale, au sens le plus large du terme. De longue date et dès avant la loi de 1901. Depuis 2014, le législateur a encore élargi son cadre et ses moyens d’intervention au risque d’en affaiblir la spécificité tant vis-à-vis des pouvoirs publics que du monde de l’entreprise. Un autre défi se profile, plus classique, mais non moins préoccupant, lorsque la législation antiterroriste ou « anti-séparatiste » menace de réactiver les mesures de contrôle préalable précisément abolies en 1901.
Mais le mouvement associatif doit lui-même s’interroger sur sa relation avec la société environnante dans laquelle il agit comme sur sa compréhension des mutations qui affectent celle-ci, sa capacité à les anticiper, les freiner, les canaliser ou les combattre.
Aussi bien la dynamique associative globale ne bénéficie-t-elle pas aux groupements de défense d’intérêts collectifs (partis, syndicats, parents d’élèves, etc.), dont les effectifs n’ont cessé de baisser depuis les années 1970-1980. Ces reculs prennent acte, certes, de l’évolution des formes d’engagement, à la fois plus horizontales et intermittentes, moins exclusives que jadis. La forte progression des associations culturelles et sportives rend compte, cependant, d’attentes accordées à la montée générale de l’individualisme, propice aux adhésions consuméristes, exemptes d’autre engagement que le paiement d’une cotisation donnant accès à des services. Ce qui, sans être tout à fait inédit, pèse sur les pratiques et l’esprit associatifs.
La sociologie a sa part dans la plus ou moins grande perméabilité des associations aux tendances lourdes de la société. L’effondrement des organisations de masse est contemporain de la « désaffiliation » de larges pans des classes populaires, qu’il enregistre et amplifie. Sans doute, la prise de responsabilité associative, à l’instar de l’intervention dans l’espace public, a-t-elle été toujours plus facile pour les membres des classes moyennes et supérieures que pour ceux issus des milieux populaires. C’est aussi de cette façon que se concrétisent, voire se « naturalisent », les rapports de domination sociale. Si le réel se joue parfois des déterminismes, les statistiques sont implacables.
En 2017, un tiers des présidents d’association sont ou avaient été chefs d’entreprise, cadres supérieurs ou membres de professions libérales, soit une proportion 2,3 fois plus importante que leur poids dans la société. L’écart est plus marqué chez les enseignants – 13 % contre 4 %, qu’avantage leur capital culturel. À l’inverse, on dénombre 5 % d’ouvriers, quand leur part parmi les actifs s’élève à près de 20%. Ces données prennent en compte l’activité passée des retraités, particulièrement bien représentés à la tête de groupements, dont 63 % des présidents ont 55 ans et plus, contre 38 % dans la population âgée de plus de 18 ans. Prime à l’expérience ? L’explication n’est pas irrecevable, elle peine toutefois à éclairer la place décroissante des femmes au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie associative. Alors qu’elles constituent 52 % de la population de plus de 18 ans et un peu plus de 50 % de l’ensemble des sociétaires, on recense 39 % de présidente. Taux en progression depuis 2005 où elles n’étaient que 31 %, mais que ne saurait justifier un moindre engagement, au contraire. En 2017, 71 % des adhérentes participent aux activités de leur association toute l’année, soit 3 points de mieux que les adhérents…
Gardons-nous de réduire le mouvement association au profil de ses présidents. On admettra cependant que présenter une telle image, inversée du reste de la population, mais encore décalée de la sociologie des bénévoles, puisse poser problème.
Merci infiniment Michel Pigenet pour le temps consacré à la rédaction de ce texte original.
Commentaires :
voir le flux Atom
ouvrir dans le navigateur