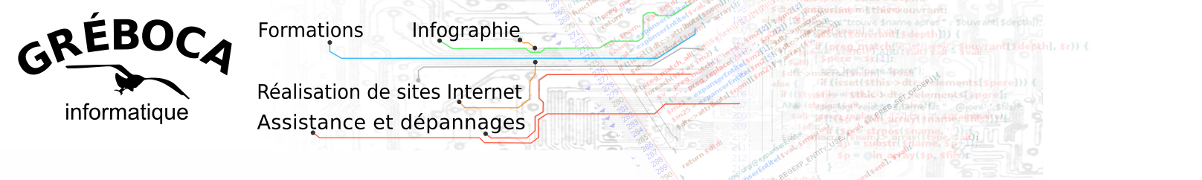Ce RFC normalise la fonction de
dérivation de clé scrypt.
À quoi ça sert, une fonction de
dérivation de clé ? Comme leur nom l'indique, elles
permettent d'obtenir des clés cryptographiques (ou autre
matériel cryptographique) à partir des données qu'on leur
fournit. Une utilisation courante est de fabriquer une clé pour
un algorithme de chiffrement, à partir d'une phrase
de passe. Cela permet d'obtenir une clé (longueur
fixe, format donné) pour les opérations cryptographiques tout en
laissant l'utilisateur manipuler uniquement des textes
mémorisables. Par exemple, pour chiffrer un disque dur,
l'utilisateur va indiquer une phrase de passe, mais le disque
sera chiffré à partir de la clé obtenue en appliquant la
fonction de dérivation de clé (KDF, pour Key Derivation
Function) à cette phrase. Une autre utilisation est
pour transformer un mot de passe qu'on doit stocker dans un
fichier en une information inutilisable pour un attaquant qui
mettrait la main dessus. Pour se connecter, on tape le mot de
passe, on refait tourner la KDF et on vérifie qu'on obtient bien
le résultat stocké.
Problème de cette méthode, l'ennemi peut tenter de faire
lui-même la dérivation : il essaie des tas de mots de passe et
regarde s'il obtient le résultat stocké. C'est pour cela qu'une
des qualités d'une bonne fonction de dérivation est,
paradoxalement, d'être lente : les gens qui
connaissent le mot de passe ne seront pas gênés (ils ne font
qu'un seul essai) alors que l'attaquant par force brute qui essaie
des milliards de mots sera ralenti. Idéalement, on voudrait une
fonction qui ne puisse pas facilement être mise en œuvre dans
des ASIC, pour qu'un attaquant riche ne
puisse pas investir dans une « machine à deviner les mots de
passe ». C'est l'un des avantages de
scrypt. (Les fanas de chaîne
de blocs noteront que des chaînes comme
Litecoin utilisent scrypt justement pour
cette raison : rendre le minage plus accessible à tous en
contrariant les ASIC.)
Pourquoi encore ajouter des fonctions de dérivation de clés
(section 1 du RFC) ?
Il y en a eu plein dans l'histoire, de la vénérable crypt à
PBKDF2 (RFC 2898) puis aux récents
bcrypt et Argon2. On en imagine souvent de
nouvelles, par exemple celle-ci qui
n'utilise pas du tout de chiffrement, juste de la
condensation. Pour résister aux attaques par
force brute (que la loi de Moore rend
plus efficace chaque année), certaines ont un nombre
d'itérations variables. On applique plusieurs fois l'opération
de dérivation, si les machines deviennent plus rapides, on
augmente ce nombre d'itérations. Cela ne marche bien que si
l'attaquant utilise les mêmes logiciels que les utilisateurs
normaux. Mais si la fonction de dérivation est facilement
programmable dans des circuits matériels spécialisés,
l'attaquant pas trop pauvre pourra s'acheter une ferme de
cassage de mots de passe, remplie de circuits conçus
spécifiquement, et travaillant en parallèle (les circuits
deviennent plus rapides mais aussi plus petits : on peut en
entasser davantage). Il ne joue alors
plus dans la même catégorie que les utilisateurs légitimes.
C'est là que scrypt intervient : l'algorithme a été
délibérement conçu pour être difficile à mettre dans un
ASIC. scrypt a été publié en 2009 (voir
l'article
original qui fut présenté à
USENIX). Ce RFC a commencé en 2013 et a
eu une longue gestation. Il ne décrit pas scrypt, renvoyant au
papier original, mais se contente de préciser les points qui
sont nécessaires pour des mises en œuvre interopérables.
La section 2 du RFC décrit les paramètres de la fonction. Le plus
évident est la phrase de passe, souvent
choisie par un humain. Il y a aussi un
sel, en général choisi aléatoirement
(RFC 4086), et divers paramètres
techniques, permettant notamment d'ajuster l'algorithme aux
caractéristiques des machines dont on dispose. Une taille de
bloc de 8 et un facteur de parallélisation de 1 conviennent bien
à l'heure actuelle, mais vont sans doute augmenter dans le
futur.
scrypt dépend de la fonction de
condensation Salsa20 Core, plus
exactement de sa version simplifiée Salsa20/8 Core
(section 3 du RFC). Une mise en œuvre en
C est incluse dans le RFC. (Voir la description originelle
et la spécification
de Salsa20.)
scrypt est un « chef d'orchestre », qui dépend de plusieurs autres algorithmes comme BlockMix (section
4), ROMix (section 5), le PBKDF2 du RFC 2898 et le
HMAC-SHA-256 du RFC 6234. L'algorithme de scrypt, qui fait
fonctionner ensemble tout cela, figure en section 6.
Si vous êtes programmeur et que vous mettez en œuvre scrypt,
les sections 8 à 13 du RFC contiennent des vecteurs
de test pour les différents algorithmes
utilisés. Par exemple, avec la phrase de passe
pleaseletmein, le sel
SodiumChloride (exemple contestable, ce sel
n'a pas été généré aléatoirement), le facteur CPU/mémoire à
16384, la taille de bloc 8 et le facteur de parallélisation 1,
la clé dérivée par scrypt sera 70 23 bd cb 3a fd 73 48
46 1c 06 cd 81 fd 38 eb fd a8 fb ba 90 4f 8e 3e a9 b5 43 f6 54
5d a1 f2 d5 43 29 55 61 3f 0f cf 62 d4 97 05 24 2a 9a f9 e6 1e
85 dc 0d 65 1e 40 df cf 01 7b 45 57 58 87. Si vous
trouvez une autre valeur, vérifiez votre programme.
Lisez aussi la section 14, consacrée aux questions
de sécurité. Par exemple, scrypt peut consommer beaucoup de
mémoire (c'est fait exprès, cela fait partie des techniques qui
rendent difficile sa mise en œuvre en
ASIC) et il y a donc un risque de
déni de service si on accepte d'exécuter
scrypt avec des paramètres quelconques, fournis depuis l'extérieur.
scrypt est, entre autres, présents dans
OpenSSL depuis le 1.1.0, officiellement
publiée juste après le RFC.