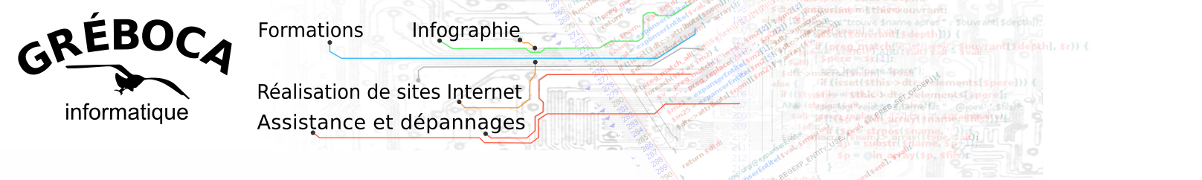On pourrait croire que la seule façon d'accéder à
l'Internet est via un
FAI commercial, géré hiérarchiquement (avec
directeur, plein de sous-directeurs, etc), dont les utilisateurs
paient pour bénéficier de l'accès (mais sans avoir leur mot à dire
sur le fonctionnement du FAI), et disposant de grands
moyens financiers et techniques. C'est certainement la vision
dominante et elle arrange bien les gens des médias et des
gouvernements, qui se retrouvent dans une situation connue, avec
un petit nombre d'acteurs « professionnels ». Heureusement,
l'Internet n'est pas comme cela : c'est une confédération de
réseaux très variés, certains effectivement gérés comme indiqué
plus haut, mais d'autres fonctionnant sur des modèles très
différents, ayant fait des choix techniques, de gouvernance et de
financement très différents et très variés. Cet excellent RFC décrit et classe les
réseaux « alternatifs ».
Il a été écrit dans le cadre du groupe de
recherche GAIA (Global Access to the Internet for
All) de l'IRTF. GAIA vise
à documenter ces déploiements « alternatifs » et à faciliter le
partage d'expérience. Outre le
simple rappel de l'existence de ces réseaux « alternatifs », son
mérite est de proposer une taxonomie de ces réseaux (forcément
imparfaite, vu leur variété) et de donner une idée de la variété
des technologies qu'ils utilisent.
Ces techniques sont en effet souvent différentes de celles
utilisées dans les réseaux « officiels »
(mainstream). Ces réseaux « alternatifs »
visent en général des situations difficiles, comme la connexion de
lieux lointains, où l'argent ne coule pas à flots. À part cela,
ces réseaux
n'ont rien en commun, ni leur organisation, ni leurs
buts. Qu'est-ce qui motive leur création ? (Au passage, le RFC
fait comme si ces réseaux « alternatifs » étaient une création
récente ; certains sont au contraire aussi vieux que l'Internet.)
Les raisons de ces projets sont elles aussi très diverses :
absence pure et simple de FAI commercial, insatisfaction vis-à-vis
des FAI officiels existants, désir d'essayer quelque chose
d'autre...
Passons au difficile jeu des définitions. Le RFC (section 1.1)
définit le réseau « officiel » (mainstream)
ainsi :
- De grande taille, par exemple à l'échelle d'un
pays,
- Gestion du réseau centralisée : tout part d'en
haut,
- Gros investissements dans l'infrastructure,
- Les utilisateurs sont de purs consommateurs : ils n'ont
absolument pas leur mot à dire, et, la plupart du temps, ils ne
reçoivent aucune information, ils ne savent pas ce qui se passe
dans le réseau qu'ils utilisent.
Et les réseaux « alternatifs », comment se définissent-ils
(section 1.2) ? C'est plus difficile car il en existe de
nombreuses variantes :
- En général de petite taille, par exemple à l'échelle d'une
région,
- La gestion du réseau n'est pas forcément
centralisée,
- Les frais d'infrastructure peuvent être très répartis (les
utilisateurs en paient parfois un bout, des infrastructures
publiques peuvent être utilisées, etc),
- Les utilisateurs ne sont pas forcément de purs
consommateurs, ils peuvent être partie prenante à la gouvernance
du réseau, et/ou à son fonctionnement technique.
Ce problème des définitions est évidemment très présent dans
tout le RFC. Par exemple, comment parler des pays qui
ne sont pas les membres de l'OCDE (et
encore, l'OCDE compte deux ou trois membres « intermédiaires ») ? Le
Tiers-Monde ? Le Sud ? Les pays pauvres ? Les sous-développés ?
Les « en voie de développement » ? La section 2 du RFC
propose des définitions :
- Nord et Sud (« global north » et
« global south ») sont utilisés pour parler,
d'une part des pays riches (même si certains, comme l'Australie,
sont au Sud) et des autres. Ce ne sont pas des termes parfaits
mais aucun ne l'est.
- Fracture numérique : la différence d'accès à l'Internet
entre les favorisés et les autres. Elle n'est pas seulement
entre pays, elle peut aussi être à l'intérieur d'un pays.
- Zones « rurales » et « urbaines » : les définitions
officielles vont varier selon les pays mais, en gros, il est
plus difficile de convaincre les opérateurs à but lucratif de
venir dans les zones à faible densité de population (zones
« rurales »).
- « Réseau libre » (Free Network) : c'est
un terme délicat, car politiquement chargé, mais notre RFC
reprend la définition de la Free Network Foundation. Dans
un réseau libre, on peut utiliser le réseau librement (la
liberté s'arrêtant évidemment là où commence la liberté des
autres, donc pas le droit de faire des
DoS par exemple), comprendre comment il
marche (pas de secrets) et on peut soi-même fournir des services
au-dessus de ce réseau.
Maintenant, les cas où on déploie ces réseaux « alternatifs »
(section 3 du RFC). Il y aurait actuellement 60 % de gens sur
Terre sans connectivité Internet. Et la répartition est très
inégale (20 % sans connexion au « Nord », 69 % au
« Sud »). Parmi les facteurs qui vont intervenir :
- La disponibilité de connexions internationales (ce n'est
pas tout de se connecter entre soi, il faut aussi se relier au
reste du monde), et de matériel,
- Les problèmes d'alimentation
électrique,
- Le contexte légal. Ici, le RFC reprend telle quelle
l'idéologie répandue à l'ISOC comme quoi
la régulation, c'est mal, et qu'il faut tout privatiser.
Dans les zones rurales, on a vu que c'était souvent pire. Johnson,
D., Pejovic, V., Belding, E., et G. van Stam, dans leur article
«
Traffic Characterization and Internet Usage in Rural
Africa » (
In Proceedings of the 20th
International Conference Companion on World Wide Web)
rapportent des
latences mesurées à
plusieurs secondes. Les problèmes des zones rurales sont souvent
cruciaux : faible revenu monétaire, manque d'infrastructures de
base comme l'électricité et les routes, densité de population
réduite, manque de compétences (les techniciens compétents
quittent rapidement ces zones pour aller en ville), etc.
La section 4 de notre RFC s'attaque ensuite au difficile
problème de la classification de ces réseaux « alternatifs ». Sur
quels critères faire cette classification ? Les auteurs du RFC en
trouvent cinq. D'abord, quelle organisation gère le réseau ? Un
groupe plus ou moins formel d'utilisateurs ? Une collectivité
publique ? Une société privée ? Un organisme de recherche ou
d'enseignement ? (En France, on aurait ajouté « Une association
loi 1901 ? »)
Second critère de classification, le but de la création de ce
réseau : fournir un accès qui n'existerait pas du tout autrement ? Fournir
une alternative bon marché ? Expérimenter et tester ? S'attaquer à
d'autres problèmes de fracture numérique (comme la littératie
numérique) ? Fournir un accès d'urgence suite à une catastrophe ?
Ou bien un but plus politique, par exemple des mécanismes de
gouvernance différents, une approche davantage « bien
commun » ? Ou fournir un accès libre et neutre, contrairement à ce que font la
quasi-totalité des FAI ? (Ce dernier point est présenté de manière
très modérée dans le RFC qui, globalement, évite de parler des
choses qui fâchent, comme la politique.)
Bien sûr, un réseau alternatif peut avoir plusieurs de ces
mobiles. Et ceux-ci peuvent être plus ou moins explicites, et ils
évoluent dans le temps. Le réseau Redhook avait commencé plutôt comme outil local, avant de devenir le seul réseau
à fonctionner après Sandy.
Un autre critère, proche du premier, est celui du modèle de
gouvernance : très ouvert, avec une participation active des
utilisateurs, ou bien plus traditionnelle, avec une organisation
centrale qui s'occupe de tout ? (On peut avoir un réseau qui est
la propriété d'un groupe d'utilisateurs mais qui, en pratique, est
géré par une petite organisation structurée.)
Autre critère, qui va plaire aux techniciens, quelles sont les
techniques employées dans ce réseau ? Wi-Fi
traditionnel ? Wi-Fi modifié pour les longues distances
(WiLD) ? WiMAX ?
Espaces blancs de la télévision (cf. RFC 7545) ? Satellite comme dans le
projet RIFE ? Voire des fibres optiques terrestres ?
Enfin, dernier critère de classification, le contexte :
zone rurale ou urbaine, Nord ou Sud.
Avec ces critères, on peut maintenant procéder à la
classification (section 5 du RFC). Notre RFC distingue (un peu
arbitrairement) six catégories, caractérisées par les réponses à
ces cinq critères. Première catégorie, les réseaux d'un groupe
local (community networks). Géré par un groupe
de citoyens proches, ils ont typiquement un fonctionnement très
ouvert et participatif. Leur croissance est en général non
planifiée et non organisée : les premiers membres se connectent
puis d'autres volontaires les rejoignent. Le mécanisme de décision
est la plupart du temps très décentralisé. En général, ils
utilisent le Wi-Fi et chaque membre contribue donc à la croissance
du réseau « physique » sous-jacent. Plusieurs exemples de tels
réseaux sont décrits dans l'article de Braem, B., Baig Vinas, R.,
Kaplan, A., Neumann, A., Vilata i Balaguer, I., Tatum, B., Matson,
M., Blondia, C., Barz, C., Rogge, H., Freitag, F., Navarro, L.,
Bonicioli, J., Papathanasiou, S., et P. Escrich, « A case for research with and on community
networks », et une analyse technique détaillée
d'un réseau d'un groupe local figure dans Vega, D., Baig, R.,
Cerda-Alabern, L., Medina, E., Meseguer, R., et L. Navarro,
« A
technological overview of the guifi.net community
network ».
Seconde catégorie, les WISP (Wireless Internet Service
Providers). Cette fois, le réseau est géré par une
société traditionnelle, mais il est « alternatif » par le public
visé (typiquement des régions rurales mal desservies, où
l'infrastructure est minimale, et où les FAI traditionnels ne vont
pas). C'est par exemple le cas de la société Airjaldi en
Inde, ou d'EveryLayer.
Troisième catégorie de réseaux alternatifs, l'infrastructure
partagée (Shared Infrastructure
model). L'infrastructure du réseau est partagée entre un
opérateur traditionnel et les utilisateurs. C'est le cas lorsque
les utilisateurs détiennent le matériel (par exemple
femtocell) mais que la gestion est
assurée par un FAI. Les utilisateurs sont payés, soit directement
par le FAI qui leur loue l'infrastructure, soit indirectement par
l'accès à l'Internet qu'ils obtiennent via ce FAI. Dans pas mal de
régions rurales dans le monde, la 3G a été
déployée ainsi, via les
femtocells. Prévue à
l'origine pour fournir une meilleure couverture dans les
bâtiments, cette technologie peut aussi être utilisée pour fournir
des accès aux téléphones mobiles sans que l'opérateur ait eu à
supporter de gros investissements.
Un exemple d'infrastructure partagée est le projet TUCAN3G, en
utilisant WiLD Ce projet est décrit par
Simo-Reigadas, J., Morgado, E., Municio, E., Prieto-Egido, I., et
A. Martinez-Fernandez dans « Assessing
IEEE 802.11 and IEEE 802.16 as backhaul technologies for rural 3G
femtocells in rural areas of developing
countries » et par Simo-Reigadas, J., Municio,
E., Morgado, E., Castro, E., Martinez-Fernandez, A., Solorzano,
L., et I. Prieto- Egido dans « Sharing
low-cost wireless infrastructures with telecommunications
operators to bring 3G services to rural
communities ».
Autre catégorie possible, les approches « foule de
volontaires » (Crowdshared approaches) où des
utilisateurs qui ne se connaissent pas forcément mettent la main
au portefeuille pour participer à un projet commun, qui sera géré
par une une société ou par eux-mêmes. Typiquement, les
utilisateurs mettent à la disposition de tous une partie de leur
capacité réseau, et l'entité qui gère le réseau est une simple
coordination, elle ne possède rien. C'est ce que promeut le mouvement
OpenWireless. Parmi les
exemples, on peut citer des sociétés comme
FON, les projets municipaux comme décrit
dans l'article de Heer, T., Hummen, R., Viol, N., Wirtz, H., Gotz,
S., et K. Wehrle, « Collaborative
municipal Wi-Fi networks- challenges and
opportunities », ou les réseaux Wi-Fi de
Sathiaseelan, A., Crowcroft, J., Goulden, M., Greiffenhagen, C.,
Mortier, R., Fairhurst, G., et D. McAuley, « Public Access WiFi Service
(PAWS) ».
Il y a aussi des réseaux montés par des coopératives en milieu
rural, ce qui forme la cinquième catégorie identifiée. Ce genre de
coopératives fournissant un service local est courant et
ancien. Le RFC cite l'exemple des
États-Unis où l'électricité en milieu rural
est souvent fournie ainsi, et ce depuis les années 1930. Ces
coopératives peuvent même passer leurs propres fibres optiques
(« CO-MO'S D.I.Y. model
for building broadband »). Des partenariats sont
possibles avec ceux qui fournissent d'autres services que
l'Internet, comme l'électricité dans l'exemple ci-dessus. Deux
exemples sont donnés dans l'article de Mitchell « Broadband
at the Speed of Light: How Three Communities Built Next-Generation
Networks » ou dans le guide « Broadband
Guide for Electric Utilities ».
Enfin, dernière catégorie de réseau alternatif, ceux créés à
des fins de recherche. Par exemple, le réseau est créé par une
université pour explorer une technique et/ou des usages (comme Bernardi, B., Buneman, P., et M. Marina, « Tegola tiered mesh network testbed in rural
Scotland »).
Après cette catégorisation des réseaux alternatifs,
penchons-nous sur les technologies utilisées (section 6 du
RFC). Le cas de réseaux filaires est rare mais existe (comme
à Lowenstedt ou dans certains endroits de Guifi.net). La plupart du temps, les réseaux
alternatifs utilisent l'hertzien. Les
normes techniques en œuvre sont en général celles du groupe
IEEE 802.
La plus connue est évidemment Wi-Fi
(802.11). Mais on trouve aussi du
GSM (une norme
ETSI) par exemple dans un
village mexicain ou dans le projet Village
Base Station. Il y a même du
GSM en logiciel
libre, dans les projets OpenBTS ou OpenBSC. Ces projets
sont en train de migrer vers des technologies plus rapides (mais,
ce que le RFC oublie de dire, bien moins libres, notamment car
pourries de brevets) comme la
4G.
On a signalé plus haut que certains réseaux peuvent utiliser
les espaces blancs laissés par la
télévision, découvrant les fréquences utilisables via une base de
données (RFC 7545) ou bien en regardant le
trafic existant pour voir si l'espace est vraiment blanc.
Le Wi-Fi est limité en portée, et certains réseaux utilisent des
techniques plus adaptées aux longues distances comme
WiMAX (IEEE 802.16)
ou bien 802.22, qui utilise justement ces
espaces blancs.
Et dans les couches au-dessus de ces couches
1 et 2, quelles techniques
utilisent les réseaux alternatifs ? La section 7 du RFC décrit
rapidement les divers choix. D'abord, la couche
3. La plupart des réseaux n'utilisent
qu'IPv4 et, ne pouvant pas obtenir
suffisamment d'adresses IP des RIR sans gros efforts, se
limitent aux adresses IP privées du RFC 1918. (Avant l'épuisement des adresses
IPv4, obtenir des adresses des RIR était plus simple que
beaucoup de gens ne le croyaient, mais il fallait quand même se
taper une bureaucratie complexe et des règles difficiles.)
Pour la plupart des réseaux alternatifs,
IPv6 était déjà normalisé depuis longtemps
lorsqu'ils ont démarré leur projet. Mais peu l'utilisent (ninux.org est une exception), probablement
essentiellement par ignorance. (Le questionnaire « Questionnaire based Examination of Community
Networks » incluait des questions sur IPv6).
Pour le routage, les choix dépendent
souvent de la structure du réseau alternatif. Certains sont de
type mesh, avec
peu ou pas d'autorité centrale, d'autres sont plus structurés. Il
y a donc des protocoles de routage traditionnels comme
OSPF (le RFC cite aussi
BGP, ce qui me surprend pour un réseau
alternatif).
Mais il y a aussi des protocoles prévus pour des réseaux moins
structurés, comme ceux utilisés dans les
MANET. On peut trouver de
l'OLSR (RFC 3626),
parfois dans des versions modifiées (ce qui est le cas de http://olsr.org/), ou parfois sa récente version 2 (RFC 7181). D'autres réseaux utilisent du
BATMAN. Le RFC cite l'excellent
Babel (RFC 6126) mais
n'indique pas s'il est très employé sur le terrain (il semble
moins connu, dans un milieu où l'information circule mal).
Et la couche au-dessus, la couche
transport ? L'un des problèmes que doit traiter cette
couche est celui de la congestion : il faut
assurer le partage de la capacité réseau entre plusieurs
acteurs. Dans les réseaux alternatifs, pas forcément gérés
centralement, et aux frontières pas toujours nettement délimitées,
le défi est encore plus important. Il peut donc être intéressant
d'enourager des protocoles « raisonnables » (RFC 6297), qui cèdent le pas
systématiquement aux autres protocoles, afin que les activités
non-critiques ne rentrent pas en compétition avec le trafic
« important ».
Enfin, les utilisateurs ne s'intéressent typiquement qu'à une
seule chose, les services, et il est donc utile de se demander ce
que ces réseaux alternatifs proposent. Il y a bien sûr tous les
services de base, notamment le
Web. Certains services très répandus (vidéo
haute définition, par exemple), peuvent être très coûteux pour les
ressources souvent limités du réseau alternatif. Leur utilisation
peut donc être restreinte. Et il y a aussi des services
spécifiques des réseaux alternatifs : des
VPN comme IC-VPN, des portails
d'intérêt local comme Tidepools, des télévisions ou radios
locales, des systèmes de relais de
VoIP pour permettre des appels bon marché,
des réseaux de capteurs permettant de la
citizen science, etc.
Voilà, c'est terminé, cet article était long mais le RFC est
plus long encore, et il se termine par une impressionnante
bibliographie dont je n'ai cité que quelques extraits : plein de
choses passionnantes à lire.