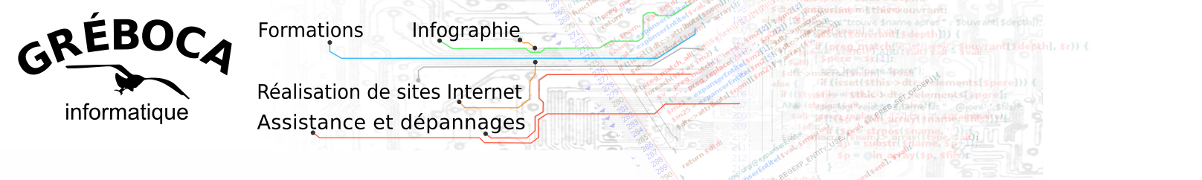Dans les débats sur l'empreinte environnementale du numérique, on
voit souvent citer des coûts énergétiques par opération élémentaire,
du genre « un message consomme X
joules » ou bien « une recherche Google brûle
autant de charbon que faire chauffer N tasses de café ». Ces
chiffres sont trompeurs, et voici pourquoi.
Lorsqu'ils sont cités, ces chiffres sont souvent accompagnés
d'injonctions à la sobriété. « N'envoyez pas ce courrier que vous
étiez en train d'écrire et vous sauverez un arbre. » En effet,
annoncer des coûts environnementaux par requête donne à penser que,
si on s'abstient d'une action, le coût diminuera d'autant. Mais ce
n'est pas ainsi que les choses se passent. Ces chiffres « par
opération » sont obtenus (normalement…) en divisant la consommation
énergétique totale par le nombre d'opérations. C'est classique,
c'est le calcul de la moyenne. Si on connait
la consommation d'essence de toutes les voitures en France, et le
nombre de voitures, calculer la consommation moyenne de chaque
voiture est simple. Certes, il faudrait tenir compte du fait qu'une
petite voiture consomme moins qu'un SUV mais,
en première approximation, cela a du sens de dire « chaque voiture
dévore N litres d'essence par an ». Et il est raisonnable d'en
déduire que de mettre des voitures supplémentaires sur la route
augmentera cette consommation, de façon proportionnelle à
l'augmentation du nombre de véhicules. La proportionnalité
s'applique également à la consommation d'essence rapportée au nombre
de kilomètres : la quantité de carburant brûlé est à peu près
proportionnelle à ce nombre de kilomètres. Si je roule deux fois
moins, je consomme deux fois moins d'essence, et ça diminuera le
relâchement de gaz à effet de serre. Dans
tous ces cas, la moyenne est un concept
mathématique parfaitement valable.
Mais tout ne fonctionne pas ainsi : la consommation électrique
des équipements réseau, par exemple, n'est pas
linéaire, elle est même souvent
constante (cela dépend des équipements ; il y un coût constant et
un variable, ce dernier étant en général plus faible que le coût constant). Que le routeur passe des
paquets ou pas, il consommera la même
quantité d'énergie. Envoyer deux fois moins de courriers ne
diminuera donc pas la consommation énergétique de votre
box, ou du reste de
l'Internet. Ainsi, le tweet de
France Culture « Savez-vous
que chaque mail envoyé, chaque vidéo regardée, émet des gaz à effet
de serre ? » est faux et trompeur. Si vous renoncez à votre
soirée devant Netflix, la consommation
électrique des routeurs,
serveurs et autres équipements ne changera
pas forcément, et calculer une moyenne par film ou série visionné n'a donc pas
beaucoup de sens. La moyenne n'est légitime que
si la dépendance est à peu près
linéaire.
Bon, OK mais, même si la moyenne n'a pas de sens et que les
déclarations sensationnalistes « envoyer un courrier, c'est relâcher
X grammes de dioxyde de carbone dans
l'atmosphère » sont à côté
de la plaque, il n'en reste pas moins que le numérique a une
empreinte environnementale, non ? Oui, la construction et
l'exploitation des réseaux informatiques a un coût (y compris
environnemental). Ce n'est pas un coût à l'utilisation,
d'accord. Mais si les gens augmentent leur activité en ligne, par
exemple si ce blog double son nombre de visiteurs, il faudra
déployer davantage de matériels (dont la construction est le
principal facteur d'empreinte environnementale du numérique) et il y
aura donc bien un résultat (néfaste…) sur l'environnement. (Le
matériel nouveau sera plus efficace : un routeur capable de 100 Gb/s
ne consommera pas dix fois plus qu'un routeur capable de 10 Gb/s. Mais sa
fabrication, on l'a vu, a un fort coût environnemental.) Bref,
chaque requête individuelle ne pèse rien, mais leur augmentation va
mener à une empreinte accrue sur l'environnement. (En sens inverse,
on pourrait se dire que, si les gens arrêtent de regarder Netflix,
cette société va éteindre certains équipements et que cela diminuera
la consommation d'électricité. Mais c'est moins certain et,
rappelez-vous, c'est surtout la fabrication qui coûte. Une fois le
serveur installé dans l'armoire, il a déjà
imprimé l'essentiel de sa marque sur l'environnement.)
Ce raisonnement (comme quoi l'effet attendu de la sobriété n'est
pas de diminuer la consommation énérgétique aujourd'hui, mais de
limiter les dépenses de matériel demain) est correct et justifie
donc qu'on porte attention aux conséquences écologiques du
numérique. La frugalité est donc une bonne chose mais attention à ne
pas la justifier par des arguments faux, comme ces coûts par
requête.
Est-ce qu'à défaut d'être scientifiquement pertinent, les
arguments fondés sur une moyenne sont au moins efficaces pour la
communication, sensibilisant les utilisatrices et utilisateurs à
l'importance de l'empreinte environnementale du numérique ? Même si
c'était le cas, ce ne serait pas à mon avis (mon avis de
rationaliste convaincu) une raison suffisante pour
l'utiliser. Tromper les gens n'est pas une bonne idée. Mais, en
plus, je ne suis même pas sûr que l'argument soit efficace : la
plupart des gens le comprendront de travers, croyant que tel ou tel
geste d'extinction va vraiment diminuer tout de suite l'empreinte
environnementale.
J'emprunte à Pierre Beyssac une terminologie intéressante
(cf. son fil
Twitter originel) : il y a le modèle « conséquentiel » qui se
focalise sur les conséquences d'un acte individuel. Je fais dix
kilomètres en voiture, cela aura des conséquences environnementales,
je renonce à prendre la voiture, il n'y aura pas de conséquences
environnementales. Et le modèle « attributif » qui consiste à
diviser une empreinte environnementale globale par le nombre
d'utilisations, même s'il n'y a pas linéarité des causes et des
effets. Le modèle conséquentiel est plus frappant (« si vous prenez
votre voiture au lieu du vélo, vous relâcherez X grammes de gaz à
effet de serre ») mais plus difficile (voire impossible) à calculer
sérieusement dans le monde du numérique. On se sert donc plutôt en
général de modèles attributifs, mais en les faisant passer pour des
modèles conséquentiels, et en utilisant la « force de frappe »
rhétorique de ces derniers, ce qui est intellectuellement
malhonnête.
Le point essentiel de cet article était que la moyenne
n'est pas forcément pertinente. Mais, sinon, que peut-on
faire pour que l'empreinte environnementale cesse d'augmenter ou en
tout cas que cette augmentation ralentisse ? Le discours médiatique
dominant est plein de conseils absurdes et évite soigneusement de
s'attaquer à des usages sacrés. On a vu ainsi un politicien qui
dénonçait l'utilisation de l'Internet pour regarder du « porno dans
l'ascenseur » mais qui se prenait en photo regardant un match de
foot depuis sa voiture. (Le sport-spectacle est intouchable, quand
on est un politicien ambitieux, pas question de le critiquer.)
Donc, voici ma liste de quelques « gisements d'économie
énergétique » importants qui ne sont pas toujours mentionnés :
- La publicité est une source
importante de dégâts environnementaux, par l'encouragement à la
consommation mais aussi par un effet plus direct, l'importance des
infrastructures qui sont dédiées à son fonctionnement en ligne. Il
est grinçant de voir sur le Web des articles critiquant
vertueusement l'« enfer numérique » mais qui contiennent des
publicités. Pour l'utilisateur·rice final·e, installer un bloqueur
de publicité est une bien meilleure action écologique que renoncer
à envoyer un message. Mais les médias n'en parleront pas (la publicité est également
sacrée).
- La surveillance de masse est également très coûteuse du
point de vue environnemental, car elle aussi dépend
d'infrastructures complexes et consommatrices (par exemple pour la
vidéo-surveillance, et c'est encore pire avec la
reconnaissance faciale). De même qu'on voit
des articles anti-Internet (lui reprochant sa consommation
électrique) qui sont hébergés sur des sites Web avec des
publicités, il est fréquent de trouver des traqueurs comme ceux de
Google Analytics sur
ces sites. Lutter contre le capitalisme de
surveillance est plus écologique que de ne pas envoyer
le courrier que vous venez d'écrire.
- La fabrication du matériel est très coûteuse du point de
vue environnemental. Changer moins souvent de matériel est donc
également une action utile.
- Question frugalité, il est important de promouvoir les
techniques qui imposent le moins de contraintes sur le réseau et
sur les machines : LEDBAT (RFC 6297) comme
algorithme de transport ou
Gemini côté application.
- En moins disruptif, on peut noter que les applications et
sites Web d'aujourd'hui sont loin d'être des modèles de
frugalité. Leur consommation importante de ressources (notamment
de temps de processeur) pousse rapidement les machines les plus
anciennes dans la catégorie « vieux trucs à jeter ». Si vous êtes
développeur ou développeuse, une des choses les plus importantes
que vous pouvez faire pour le climat est de développer des
applications et sites plus frugaux. (Et d'envoyer promener le
marketeux qui dira « c'est moche, c'est trop austère, le client ne
va pas aimer ».) C'est ce que prône par exemple le courant
small
Web ou slow Web. (On peut
aussi citer l'intéressant Low-tech
magazine, pour les bricoleur·ses.)
On trouve en ligne (ou sur papier…) plein de ressources sur
l'empreinte environnementale du numérique. Toutes ne sont pas
sérieuses, loin de là. En voici quelques-unes qui sont utiles (ce qui
ne veut pas dire que je suis 100 % d'accord avec leurs auteurs) :